Dans cette vidéo, Albert Faahei Hugues nous raconte son parcours d'apprentissage et de promotion de sa langue paternelle, le reo magareva.
Auteur et orateur ("Littéramā'ohi" "Pīna'ina'i") pour la valorisation des héritages immatériels et matériels autochtones, président de l’association culturelle et linguistique Te ana pouga magareva, Albert Faahei Hugues est aussi doctorant en Linguistique polynésienne à l'Université de Polynésie française, professeur d'histoire géographie et de lettres-reo magareva au collège mangarévien Re’e Saint-Raphaël, traducteur en reo tahiti (tahitien) et en reo magareva (mangarévien).
Le reo magareva est une langue polynésienne de la famille des langues océaniennes, qui sont une branche de l'immense famille des langues austronésiennes.
Le reo magareva est une langue polynésienne de la famille des langues océaniennes, parlée dans l'Archipel des Gambier depuis l'arrivée des premiers habitants autochtones au 12e siècle. Les premiers habitants de l'archipel étaient, comme leurs ancêtres navigateurs austronésiens initialement partis de Taïwan il y a trois mille ans, des horticulteurs, qui ont débarqué avec leurs plantes et ont cultivé les îles habitables.
En 1797, un navigateur britannique aperçoit ces îles. En 1826, un officier britannique y débarque et rencontre le roi Maputeoa, qui réside à Rikitea. Des cinq mille habitants de l'époque, il ne reste plus que 463 personnes en 1887. En moins de soixante ans, c'est 90% de la population qui a été décimée par les maladies introduites par les Européens, les conflits, les déplacements forcés et le travail forcé.
Un siècle et demi plus tard, environ mille six cents personnes vivent dans l'Archipel, mais seulement cinq cents parlent encore, plus ou moins, le reo magareva, qui est donc une langue très menacée. La politique d'acculturation menée par la France a eu des effets désastreux sur la pratique de cette langue, mais depuis quelques années, grâce à des Mangaréviennes et Mangaréviens engagés, langue et culture sont transmis à nouveau aux jeunes générations et à leurs parents, qui avaient été coupés de leurs racines.
Les divinités mangaréviennes traditionnelles ont été brûlées sur des bûchers lors de grands autodafés en 1835. Seules onze sculptures survivent à cette destruction culturelle et spirituelle. Elles ont été envoyées à l’époque par les missionnaires au Vatican. Parmi elles, on trouve :
- Tū, divinité liée à l'arbre à pain et à ses fruits, dont le culte s'organise principalement autour de la cérémonie uaikai se déroulant sur le marae principal Te Ke’ika au moment de la formation des fruits de l'arbre à pain (tūmei, tumu mei),
- Rao, divinité invoquée lors de la plantation du curcuma longa (rega). Celui-ci n’est plus cultivé de nos jours à Mangareva, mais autrefois, il était si hautement estimé qu’il était placé sous la protection de trois divinités : Mei’ara-iti, Raga’au et Rogo ; Rogo était chargé de faire tomber la pluie et de produire des nourritures ; il était symbolisé par l’arc-en-ciel et la brume et possédait les attributs du dieu de l’horticulture. Deux autres divinités, Rao et Tūpō, étaient plus particulièrement invoquées au cours de la plantation du rega ; des prêtres, nommés ta’ura rega, conduisaient les cérémonies offertes au moment de sa mise en culture et de la cuisson de ses tubercules.
Parmi les richesses uniques de la culture mangarévienne, détruite mais paradoxalement aussi décrite par les missionnaires, on trouve la danse traditionnelle pe’i exécutée avec grâce et énergie. Elle est accompagnée par des percussions (des tambours appelés pa'u) et des chants. Le terme pe’i signifie « battement de pied sur la terre ».
▶️ https://youtu.be/nlHVSt64OCY?si=G7tvE-6tFsGenpdL
▶️ https://youtu.be/9lu7o8TPVv0?si=Z5fpYAiVPDv71f5w
▶️ https://youtu.be/-fuMb6n2oXA?si=baNXyCdAWONkvrk0
En savoir plus :
????https://www.casoar.org/histoire/2020/04/08/la-sculpture-de-mangareva-entre-vestiges-ethnographiques-et-temoins-de-la-missionnarisation
????Catherine Orliac, “Le Dieu Rao de Mangareva et le Curcuma longa”, Journal de la Société des Océanistes, 114-115 | Année 2002. URL: http://journals.openedition.org/jso/1535; DOI: https://doi.org/10.4000/jso.1535
????Florence Mury, Les échelles des renaissances culturelles en Polynésie française, thèse de doctorat, 2022. https://hal.science/tel-03926851v2/file/2022LIMO0113.pdf
La série #Locuteurs de l'ILARA présente des femmes et des hommes qui parlent des langues autochtones rares et précieuses. Leurs témoignages et leurs histoires nous ouvrent une fenêtre sur cette expérience intime.
https://ilara.hypotheses.org/locuteurs
@ephe-psl @CampusCondorcet @universitedelapolynesiefra8665 @PSL-Universite @tefarenatura-lecomusee681
Réseaux sociaux de l’ILARA :
- Facebook : https://www.facebook.com/ILARA.EPHE
- Twitter : https://twitter.com/ILARA_EPHE
- Instagram : https://www.instagram.com/ilaraephe/
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ilara-institut-des-langues-rares/
Auteur et orateur ("Littéramā'ohi" "Pīna'ina'i") pour la valorisation des héritages immatériels et matériels autochtones, président de l’association culturelle et linguistique Te ana pouga magareva, Albert Faahei Hugues est aussi doctorant en Linguistique polynésienne à l'Université de Polynésie française, professeur d'histoire géographie et de lettres-reo magareva au collège mangarévien Re’e Saint-Raphaël, traducteur en reo tahiti (tahitien) et en reo magareva (mangarévien).
Le reo magareva est une langue polynésienne de la famille des langues océaniennes, qui sont une branche de l'immense famille des langues austronésiennes.
Le reo magareva est une langue polynésienne de la famille des langues océaniennes, parlée dans l'Archipel des Gambier depuis l'arrivée des premiers habitants autochtones au 12e siècle. Les premiers habitants de l'archipel étaient, comme leurs ancêtres navigateurs austronésiens initialement partis de Taïwan il y a trois mille ans, des horticulteurs, qui ont débarqué avec leurs plantes et ont cultivé les îles habitables.
En 1797, un navigateur britannique aperçoit ces îles. En 1826, un officier britannique y débarque et rencontre le roi Maputeoa, qui réside à Rikitea. Des cinq mille habitants de l'époque, il ne reste plus que 463 personnes en 1887. En moins de soixante ans, c'est 90% de la population qui a été décimée par les maladies introduites par les Européens, les conflits, les déplacements forcés et le travail forcé.
Un siècle et demi plus tard, environ mille six cents personnes vivent dans l'Archipel, mais seulement cinq cents parlent encore, plus ou moins, le reo magareva, qui est donc une langue très menacée. La politique d'acculturation menée par la France a eu des effets désastreux sur la pratique de cette langue, mais depuis quelques années, grâce à des Mangaréviennes et Mangaréviens engagés, langue et culture sont transmis à nouveau aux jeunes générations et à leurs parents, qui avaient été coupés de leurs racines.
Les divinités mangaréviennes traditionnelles ont été brûlées sur des bûchers lors de grands autodafés en 1835. Seules onze sculptures survivent à cette destruction culturelle et spirituelle. Elles ont été envoyées à l’époque par les missionnaires au Vatican. Parmi elles, on trouve :
- Tū, divinité liée à l'arbre à pain et à ses fruits, dont le culte s'organise principalement autour de la cérémonie uaikai se déroulant sur le marae principal Te Ke’ika au moment de la formation des fruits de l'arbre à pain (tūmei, tumu mei),
- Rao, divinité invoquée lors de la plantation du curcuma longa (rega). Celui-ci n’est plus cultivé de nos jours à Mangareva, mais autrefois, il était si hautement estimé qu’il était placé sous la protection de trois divinités : Mei’ara-iti, Raga’au et Rogo ; Rogo était chargé de faire tomber la pluie et de produire des nourritures ; il était symbolisé par l’arc-en-ciel et la brume et possédait les attributs du dieu de l’horticulture. Deux autres divinités, Rao et Tūpō, étaient plus particulièrement invoquées au cours de la plantation du rega ; des prêtres, nommés ta’ura rega, conduisaient les cérémonies offertes au moment de sa mise en culture et de la cuisson de ses tubercules.
Parmi les richesses uniques de la culture mangarévienne, détruite mais paradoxalement aussi décrite par les missionnaires, on trouve la danse traditionnelle pe’i exécutée avec grâce et énergie. Elle est accompagnée par des percussions (des tambours appelés pa'u) et des chants. Le terme pe’i signifie « battement de pied sur la terre ».
▶️ https://youtu.be/nlHVSt64OCY?si=G7tvE-6tFsGenpdL
▶️ https://youtu.be/9lu7o8TPVv0?si=Z5fpYAiVPDv71f5w
▶️ https://youtu.be/-fuMb6n2oXA?si=baNXyCdAWONkvrk0
En savoir plus :
????https://www.casoar.org/histoire/2020/04/08/la-sculpture-de-mangareva-entre-vestiges-ethnographiques-et-temoins-de-la-missionnarisation
????Catherine Orliac, “Le Dieu Rao de Mangareva et le Curcuma longa”, Journal de la Société des Océanistes, 114-115 | Année 2002. URL: http://journals.openedition.org/jso/1535; DOI: https://doi.org/10.4000/jso.1535
????Florence Mury, Les échelles des renaissances culturelles en Polynésie française, thèse de doctorat, 2022. https://hal.science/tel-03926851v2/file/2022LIMO0113.pdf
La série #Locuteurs de l'ILARA présente des femmes et des hommes qui parlent des langues autochtones rares et précieuses. Leurs témoignages et leurs histoires nous ouvrent une fenêtre sur cette expérience intime.
https://ilara.hypotheses.org/locuteurs
@ephe-psl @CampusCondorcet @universitedelapolynesiefra8665 @PSL-Universite @tefarenatura-lecomusee681
Réseaux sociaux de l’ILARA :
- Facebook : https://www.facebook.com/ILARA.EPHE
- Twitter : https://twitter.com/ILARA_EPHE
- Instagram : https://www.instagram.com/ilaraephe/
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ilara-institut-des-langues-rares/
- Catégories
- Cours de Batterie & Percussions
- Mots-clés
- #Magareva, #Reomagareva, #Gambier

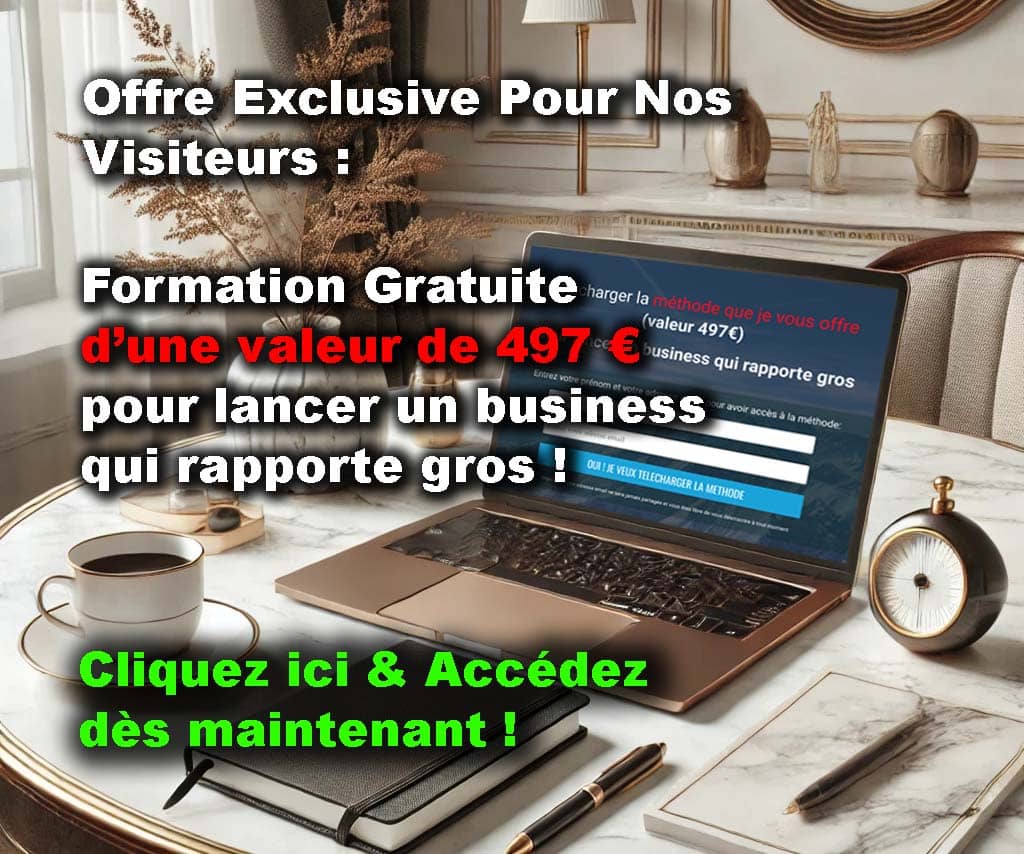
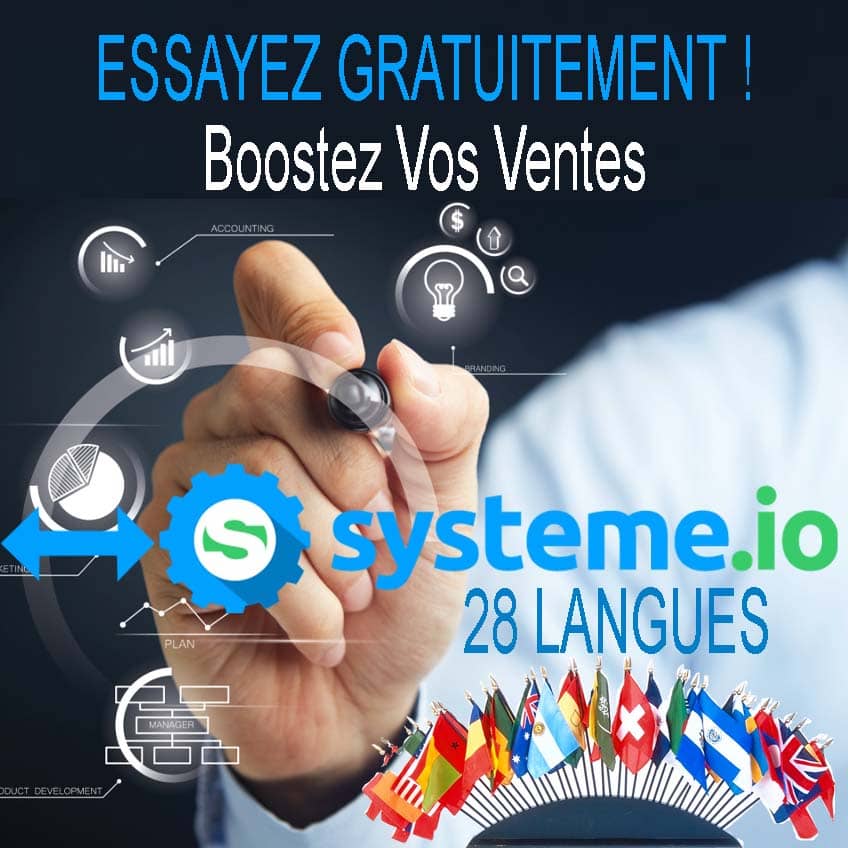


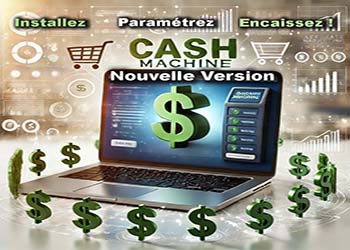







Commentaires