Chimies Situées : Quels avenirs aborder avec quelles chimies ? #1/5
La chimie se trouve vers le milieu de l’ordonnancement positiviste des six sciences fondamentales qu’Auguste Comte publia au XIXème siècle. Nous avons hérité de ce positivisme l'organisation scientifique actuelle, basée sur la subdivision, voir le cloisonnement, disciplinaire. La complexité et la nature systémique des changements rapides que nous observons renforcent les appels à des changements profonds sur la façon dont les séparations disciplinaires doivent être surmontées pour améliorer la science.
Ce cours explore le couplage de la chimie, science de la transformation de la matière, avec la théorie de savoirs situés, issue des sciences sociales, en fondant le cadre de réflexion « Chimies Situées ». Plutôt que de tenter d’expliciter le lien, qui reste la plupart du temps impensé ou du moins dans l’ombre, entre la situation (au sens large) d'un.e chercheur.euse et la partialité de son évaluation des preuves scientifiques, le cadre des « Chimies Situées » se tourne résolument vers nos imaginaires : « Quel avenir voulez-vous aborder avec la chimie? ». Entre exemples (et contre-exemples…) tirés de la littérature scientifique, et données d’enquête auprès de collègues, ce cours tente de situer des recherches en chimie, en explorant un ensemble de moteurs d’action sur lesquels les chimistes interrogé.e.s souhaitent s‘appuyer (chimie pour la justice sociale, chimie pour sur la santé humaine, chimie pour la croissance économique, chimie pour le plaisir intellectuel de la recherche, chimie de réponse à l’effondrement, chimie frugale, chimie de réduction de dégâts,....).
Le cours se conclura sur une ébauche des limites imposées par l’enchevêtrement de ces « moteurs souhaités subjectifs » avec les intérêts, les statuts, les moyens, les systèmes techno-économiques et les pratiques qui se croisent et orientent le monde de la recherche. En posant une question-horizon : dans quelle mesure cette approche peut-elle accroître le pouvoir transformateur à la fois du.de la scientifique et de ses recherches ? Dans quelle mesure, en d’autres mots, cette démarche a-t-elle un potentiel politique ?
Détail du cours
Lien à l’Anthropocène : La puissance du terme Anthropocène, qui relie les limites planétaires du système Terre, les sociétés et le temps, explique en partie pourquoi ce terme est en train de faire éclater sa portée sémantique initiale au-delà de la géologie. Les géosciences sont à la base du concept d'Anthropocène et elles sont également à l'origine de notre capacité à exploiter les ressources et à modifier leur répartition sur la planète (métaux, roches, vecteurs énergétiques, eau, ...). La chimie, la science qui étudie les propriétés et le comportement de la matière, n'est pas loin car avec la compréhension de la matière vient la capacité de la transformer et de la modeler en formes plus proches de notre usage (matériaux de construction, carburants, engrais,...). Inscrire la chimie dans l’Anthropocène c’est aussi relier la chimie aux limites planétaires du système Terre, les sociétés et le temps.
Déroulé des cours :
Le premier cours servira d’introduction au cadre « Chimies Situées : Quels avenirs aborder avec quelles chimies ? », avec en fil rouge un talisman des chimistes : le tableau périodique ou plutôt des tableaux périodiques qui mettent en avant, tour à tour, une chimie absolue-fille de la physique quantique et hors-sol- qui parle d’ontologie, et une chimie inscrite dans le système Terre et ses limites- qui parle de matérialité. Les connaissances en chimie nécessaires aux non-chimistes pour suivre ce cours seront données.
Alessandra QUADRELLI (France), directrice de Recherche CNRS (UMR 5265
"IRCELYON")
"Je travaille au CNRS, centre national de la recherche scientifique, depuis 2002. Je conduis mes recherches auprès de l’Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon (UMR 5256 CNRS -Université de Lyon 1) en tant que directrice de recherche en chimie."
La chimie se trouve vers le milieu de l’ordonnancement positiviste des six sciences fondamentales qu’Auguste Comte publia au XIXème siècle. Nous avons hérité de ce positivisme l'organisation scientifique actuelle, basée sur la subdivision, voir le cloisonnement, disciplinaire. La complexité et la nature systémique des changements rapides que nous observons renforcent les appels à des changements profonds sur la façon dont les séparations disciplinaires doivent être surmontées pour améliorer la science.
Ce cours explore le couplage de la chimie, science de la transformation de la matière, avec la théorie de savoirs situés, issue des sciences sociales, en fondant le cadre de réflexion « Chimies Situées ». Plutôt que de tenter d’expliciter le lien, qui reste la plupart du temps impensé ou du moins dans l’ombre, entre la situation (au sens large) d'un.e chercheur.euse et la partialité de son évaluation des preuves scientifiques, le cadre des « Chimies Situées » se tourne résolument vers nos imaginaires : « Quel avenir voulez-vous aborder avec la chimie? ». Entre exemples (et contre-exemples…) tirés de la littérature scientifique, et données d’enquête auprès de collègues, ce cours tente de situer des recherches en chimie, en explorant un ensemble de moteurs d’action sur lesquels les chimistes interrogé.e.s souhaitent s‘appuyer (chimie pour la justice sociale, chimie pour sur la santé humaine, chimie pour la croissance économique, chimie pour le plaisir intellectuel de la recherche, chimie de réponse à l’effondrement, chimie frugale, chimie de réduction de dégâts,....).
Le cours se conclura sur une ébauche des limites imposées par l’enchevêtrement de ces « moteurs souhaités subjectifs » avec les intérêts, les statuts, les moyens, les systèmes techno-économiques et les pratiques qui se croisent et orientent le monde de la recherche. En posant une question-horizon : dans quelle mesure cette approche peut-elle accroître le pouvoir transformateur à la fois du.de la scientifique et de ses recherches ? Dans quelle mesure, en d’autres mots, cette démarche a-t-elle un potentiel politique ?
Détail du cours
Lien à l’Anthropocène : La puissance du terme Anthropocène, qui relie les limites planétaires du système Terre, les sociétés et le temps, explique en partie pourquoi ce terme est en train de faire éclater sa portée sémantique initiale au-delà de la géologie. Les géosciences sont à la base du concept d'Anthropocène et elles sont également à l'origine de notre capacité à exploiter les ressources et à modifier leur répartition sur la planète (métaux, roches, vecteurs énergétiques, eau, ...). La chimie, la science qui étudie les propriétés et le comportement de la matière, n'est pas loin car avec la compréhension de la matière vient la capacité de la transformer et de la modeler en formes plus proches de notre usage (matériaux de construction, carburants, engrais,...). Inscrire la chimie dans l’Anthropocène c’est aussi relier la chimie aux limites planétaires du système Terre, les sociétés et le temps.
Déroulé des cours :
Le premier cours servira d’introduction au cadre « Chimies Situées : Quels avenirs aborder avec quelles chimies ? », avec en fil rouge un talisman des chimistes : le tableau périodique ou plutôt des tableaux périodiques qui mettent en avant, tour à tour, une chimie absolue-fille de la physique quantique et hors-sol- qui parle d’ontologie, et une chimie inscrite dans le système Terre et ses limites- qui parle de matérialité. Les connaissances en chimie nécessaires aux non-chimistes pour suivre ce cours seront données.
Alessandra QUADRELLI (France), directrice de Recherche CNRS (UMR 5265
"IRCELYON")
"Je travaille au CNRS, centre national de la recherche scientifique, depuis 2002. Je conduis mes recherches auprès de l’Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon (UMR 5256 CNRS -Université de Lyon 1) en tant que directrice de recherche en chimie."
- Catégories
- Cours de Batterie & Percussions
- Mots-clés
- science, anthropocène, chimie

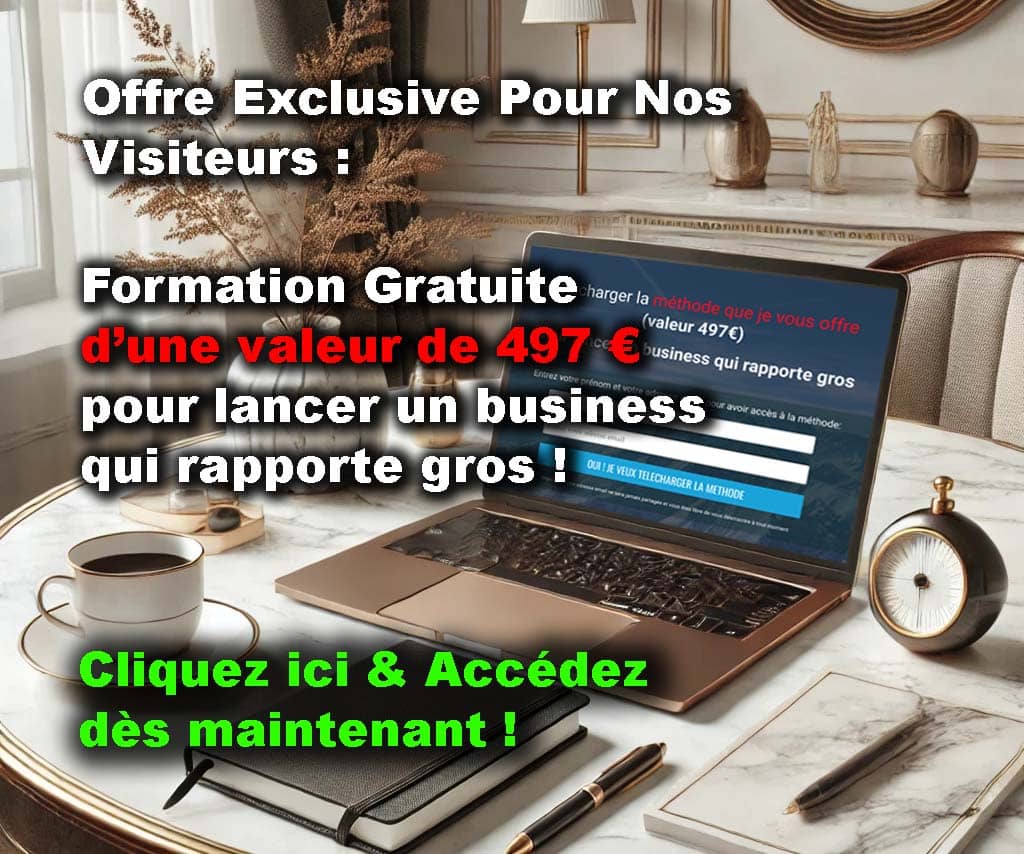
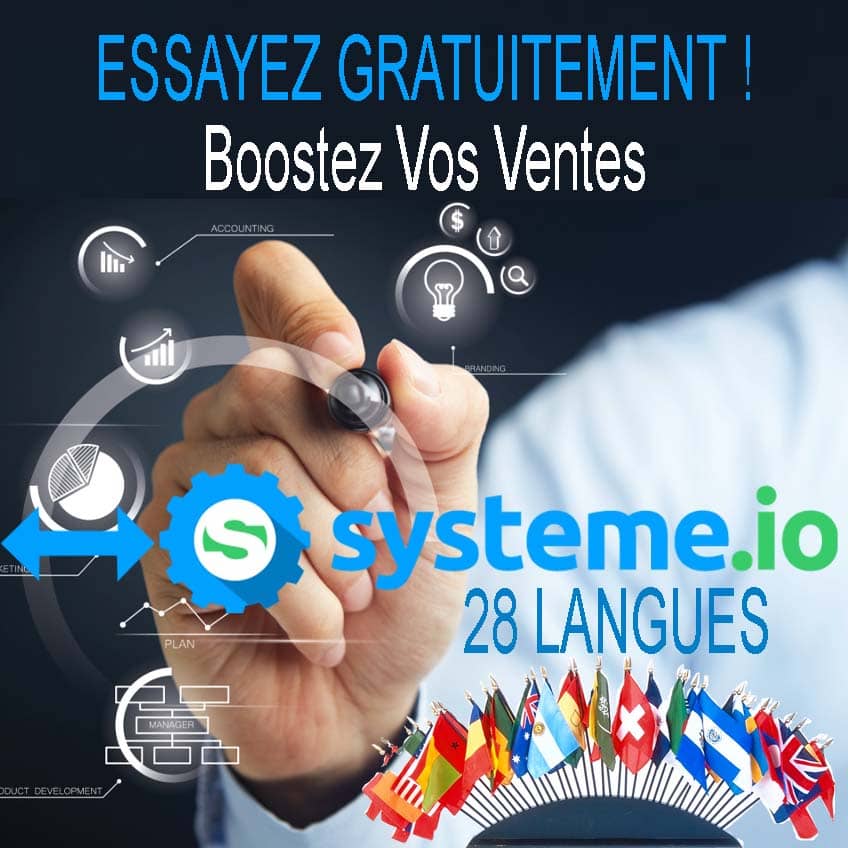


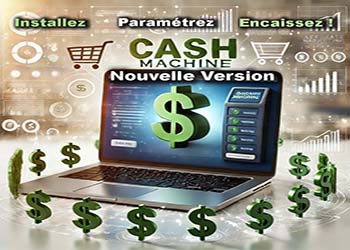








Commentaires