Alexandre Kantorow interprète le Concerto pour piano n° 2 en si bémol majeur, op. 83 de Brahms avec l'OP de Radio France sous la direction du chef britannique John Eliot Gardiner. Extrait du concert enregistré le 26 mars 2025 à l'Auditorium de la Maison de la Musique et de la Radio.
#piano #brahms #kantorow #concerto
Excellent pianiste, Brahms s’est d’abord consacré à la composition d’œuvres pour piano et de musique de chambre, n’approchant l’orchestre que peu à peu, et par étapes. Ses trois sonates pour piano datent ainsi de sa prime jeunesse, ses quatre symphonies, de sa maturité. Parmi les chemins détournés qu’il emprunte avant d’achever en 1876 sa Première Symphonie figurent les deux sérénades pour orchestre et le Premier Concerto pour piano, en trois mouvements, d’abord conçu comme une symphonie. Celui-ci connaît un cinglant échec public lors de sa création en 1859, poussant Brahms à prendre sa revanche avec un nouveau concerto pour piano, qui ne voit le jour qu’au début des années 1880. Entretemps sont nées les deux premières symphonies et, en 1878, le Concerto pour violon, dont la genèse est liée à celle du futur Concerto pour piano. Brahms hésite en effet à écrire d’abord pour l’un ou pour l’autre instrument. Les deux mouvements intermédiaires du Second Concerto pourraient même avoir été initialement destinés au Concerto pour violon. Si tel est le cas, le changement de destination ne peut manquer de surprendre, tant les deux instruments sont radicalement différents, mais Beethoven n’a-t-il pas transcrit pour piano la partie soliste de son propre Concerto pour violon (op. 61a) ? Quoi qu’il en soit, le Second Concerto est finalement mené à bien pendant l’été 1881, et Brahms l’annonce plaisamment à une amie comme un « minuscule petit concerto pour piano avec un tout petit bout de scherzo »…
Anxieux, il prend soin d’« essayer » l›œuvre nouvelle lors d’auditions privées avant sa création publique, l’automne suivant, à Budapest. Précaution inutile : le public lui fait un excellent accueil, justifiant l’ambition et la persévérance du compositeur qui signe là son œuvre orchestrale la plus ample et la plus lumineuse, l’un des concertos les plus imposants du répertoire et les plus aimés du public. Par ses proportions et ses quatre mouvements, inhabituels dans ce genre (quoique Liszt, ou Saint-Saëns, plus tard Prokofiev l’expérimentent aussi), ce concerto s’apparente à une symphonie. Pourtant, il est, à bien des égards, aux antipodes de son prédécesseur de 1859.
Autant ce dernier était rude et « nordique », autant celui-ci, certes fougueux dans ses deux premiers mouvements, bénéficie d’un orchestre aéré et d’une légèreté de touche jamais atteinte par Brahms dans ses autres œuvres orchestrales. Le piano alternativement se fond ou dialogue avec l’orchestre, moins force d’opposition que partenaire malgré l’écriture instrumentale somptueuse et l’extrême noblesse de la virtuosité déployée par le soliste. L’amorce de l’Allegro non troppo initial est confiée au cor solo, avant que le piano 11 n’entame une cadence introductive. Ce geste inoubliable, repris et amplifié au début du développement puis au moment de la réexposition, jalonne le gigantesque morceau de presque vingt minutes. Lancé cette fois par le pianiste, le tumultueux Allegro appassionato tient lieu de scherzo avec, en son centre, un épisode où les cordes de l’orchestre, soutenues par les vents, prennent des accents presque baroques. Dans l’Andante, un violoncelle s’épanche d’abord en un long solo, repris à la fin orné de trilles du piano ; au cours du mouvement, d’autres voix se détachent de l’orchestre : hautbois, flûte, clarinettes... L’ambiance nocturne et méditative de cette page merveilleuse a amené certains à y voir le souvenir d’une nuit de pleine lune à Taormina, sur la côte sicilienne, où Brahms avait séjourné. Quant à l’Allegretto grazioso final, il reste dans une veine méridionale grâce à son capricieux et ravissant premier thème, entamé d›entrée de jeu par un piano à peine accompagné, et au parfum hongrois - ou plutôt tzigane - de son thème central. Ici comme ailleurs, l’art brahmsien de la variation ne peut qu’éblouir.
Pensez à vous abonner pour découvrir d’autres vidéos France Musique !
https://www.youtube.com/channel/UCiPYZkZeNbYTQZKNMlB0Gsw?sub_confirmation=1
Découvrez tout France Musique :
► Site internet - https://www.radiofrance.fr/francemusique
► Espace Concerts - https://www.radiofrance.fr/concerts
► Newsletters - https://www.radiofrance.fr/francemusique/newsletters
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
► Facebook - https://facebook.com/FranceMusique
► Twitter - https://twitter.com/francemusique?lang=fr
► Instagram - https://www.instagram.com/francemusique/?hl=fr
► TikTok - https://www.tiktok.com/@francemusique?lang=fr
#piano #brahms #kantorow #concerto
Excellent pianiste, Brahms s’est d’abord consacré à la composition d’œuvres pour piano et de musique de chambre, n’approchant l’orchestre que peu à peu, et par étapes. Ses trois sonates pour piano datent ainsi de sa prime jeunesse, ses quatre symphonies, de sa maturité. Parmi les chemins détournés qu’il emprunte avant d’achever en 1876 sa Première Symphonie figurent les deux sérénades pour orchestre et le Premier Concerto pour piano, en trois mouvements, d’abord conçu comme une symphonie. Celui-ci connaît un cinglant échec public lors de sa création en 1859, poussant Brahms à prendre sa revanche avec un nouveau concerto pour piano, qui ne voit le jour qu’au début des années 1880. Entretemps sont nées les deux premières symphonies et, en 1878, le Concerto pour violon, dont la genèse est liée à celle du futur Concerto pour piano. Brahms hésite en effet à écrire d’abord pour l’un ou pour l’autre instrument. Les deux mouvements intermédiaires du Second Concerto pourraient même avoir été initialement destinés au Concerto pour violon. Si tel est le cas, le changement de destination ne peut manquer de surprendre, tant les deux instruments sont radicalement différents, mais Beethoven n’a-t-il pas transcrit pour piano la partie soliste de son propre Concerto pour violon (op. 61a) ? Quoi qu’il en soit, le Second Concerto est finalement mené à bien pendant l’été 1881, et Brahms l’annonce plaisamment à une amie comme un « minuscule petit concerto pour piano avec un tout petit bout de scherzo »…
Anxieux, il prend soin d’« essayer » l›œuvre nouvelle lors d’auditions privées avant sa création publique, l’automne suivant, à Budapest. Précaution inutile : le public lui fait un excellent accueil, justifiant l’ambition et la persévérance du compositeur qui signe là son œuvre orchestrale la plus ample et la plus lumineuse, l’un des concertos les plus imposants du répertoire et les plus aimés du public. Par ses proportions et ses quatre mouvements, inhabituels dans ce genre (quoique Liszt, ou Saint-Saëns, plus tard Prokofiev l’expérimentent aussi), ce concerto s’apparente à une symphonie. Pourtant, il est, à bien des égards, aux antipodes de son prédécesseur de 1859.
Autant ce dernier était rude et « nordique », autant celui-ci, certes fougueux dans ses deux premiers mouvements, bénéficie d’un orchestre aéré et d’une légèreté de touche jamais atteinte par Brahms dans ses autres œuvres orchestrales. Le piano alternativement se fond ou dialogue avec l’orchestre, moins force d’opposition que partenaire malgré l’écriture instrumentale somptueuse et l’extrême noblesse de la virtuosité déployée par le soliste. L’amorce de l’Allegro non troppo initial est confiée au cor solo, avant que le piano 11 n’entame une cadence introductive. Ce geste inoubliable, repris et amplifié au début du développement puis au moment de la réexposition, jalonne le gigantesque morceau de presque vingt minutes. Lancé cette fois par le pianiste, le tumultueux Allegro appassionato tient lieu de scherzo avec, en son centre, un épisode où les cordes de l’orchestre, soutenues par les vents, prennent des accents presque baroques. Dans l’Andante, un violoncelle s’épanche d’abord en un long solo, repris à la fin orné de trilles du piano ; au cours du mouvement, d’autres voix se détachent de l’orchestre : hautbois, flûte, clarinettes... L’ambiance nocturne et méditative de cette page merveilleuse a amené certains à y voir le souvenir d’une nuit de pleine lune à Taormina, sur la côte sicilienne, où Brahms avait séjourné. Quant à l’Allegretto grazioso final, il reste dans une veine méridionale grâce à son capricieux et ravissant premier thème, entamé d›entrée de jeu par un piano à peine accompagné, et au parfum hongrois - ou plutôt tzigane - de son thème central. Ici comme ailleurs, l’art brahmsien de la variation ne peut qu’éblouir.
Pensez à vous abonner pour découvrir d’autres vidéos France Musique !
https://www.youtube.com/channel/UCiPYZkZeNbYTQZKNMlB0Gsw?sub_confirmation=1
Découvrez tout France Musique :
► Site internet - https://www.radiofrance.fr/francemusique
► Espace Concerts - https://www.radiofrance.fr/concerts
► Newsletters - https://www.radiofrance.fr/francemusique/newsletters
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
► Facebook - https://facebook.com/FranceMusique
► Twitter - https://twitter.com/francemusique?lang=fr
► Instagram - https://www.instagram.com/francemusique/?hl=fr
► TikTok - https://www.tiktok.com/@francemusique?lang=fr
- Catégories
- Cours de Violon
- Mots-clés
- 26 Mars 2025, Alexandre Kantorow, France Musique

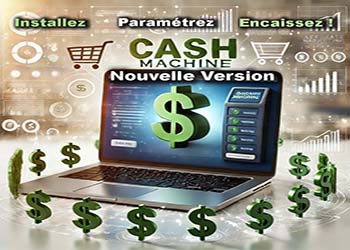
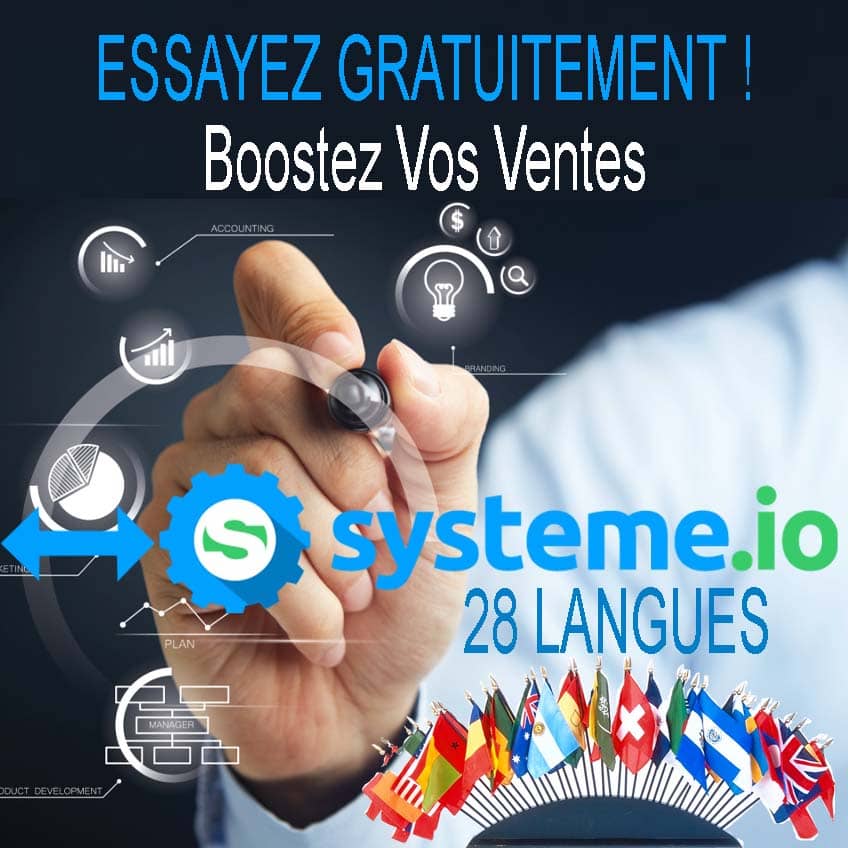









Commentaires